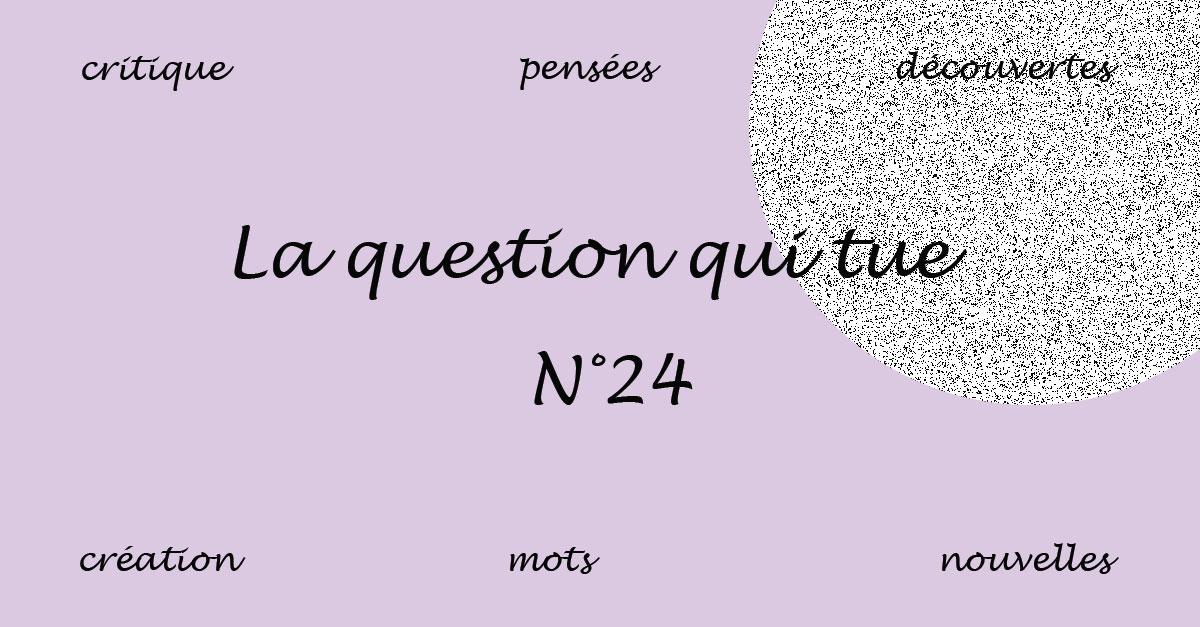Pensez-vous aux lectrices et lecteurs quand vous écrivez et tenez-vous compte de leurs remarques pour votre prochain livre?
[question adressée par Guy N., Luxembourg]
Cher Guy,
Je vous suis reconnaissante à double titre: de m’avoir adressé une question, et de me permettre d’y répondre à l’aide d’un seul mot: non.
Voilà, c’est donc tout pour cette question qui tue No 24.
Encore merci, cher Guy.
Ah, j’y pense! Vous aimeriez savoir pourquoi, n’est-ce pas?
Le sais-je moi-même? Pas vraiment. D’autant que, sur ce point précis, je préfère m’en tenir à l’instinct, n’hésitant pas à le qualifier de salvateur. La vérité est que j’écris en effet sans jamais penser aux lecteurs-lectrices, ni à personne d’autre d’ailleurs. Et je ne laisse personne lire, pas même un éditeur, tant qu’un texte n’est pas terminé.
Peut-être allez-vous en déduire que je crains le regard d’autrui? Faites, je vous en prie. Il n’empêche que ce que je crains avant toute chose, c’est de ne pas être assez à l’écoute du texte en train d’être écrit.
Comment vous expliquer simplement un phénomène aussi difficile à illustrer, parce que fragile et insaisissable?
Essayons.
Imaginons que vous ayez besoin d’un costume sur mesure et que vous me demandiez de le tailler. Vous ferez vos propres choix de tissus et de couleurs, nous discuterons de la coupe, de vos souhaits particuliers, du budget, je prendrai vos mesures et travaillerai en tenant compte de la nature du tissu et de vos vœux. Il en irait de même si vous me commandiez un meuble, un repas pour vingt personnes, un alambic pour vos expériences chimiques etc. N’est-il pas évident que votre voisin, me passant commande pour des besoins similaires, me ferait part d’impératifs différents des vôtres? Sans parler de l’épouse du voisin qui aurait d’autres souhaits encore…
Vais-je, dès lors, écrire trois histoires différentes, afin de plaire à chacun d’entre vous? Au nom de quoi? Ou alors, dois-je écrire quelque chose de si consensuel et de si général, genre prêt-à-porter de grand magasin, au point que mon roman-T-shirt finisse par pouvoir, grosso modo, être porté par chacun?
Non merci, d’autres s’en chargent très bien à ma place.
Il se trouve, à tout le moins à mes yeux, que la littérature n’est pas un «produit». Elle n’a pas à «convenir». Elle n’a pas à être «fabriquée», et ceci en dépit du respect que j’éprouve envers les artisans qui fabriquent des produits sur mesure, et dont le talent relève parfois davantage de l’art que de l’artisanat.
Un texte en train d’être écrit est quelque chose de vivant. D’aussi vivant que moi-même. Je ressens donc l’écriture d’un texte littéraire dans un rapport de vivant à vivant, qui interagissent sans cesse. Et non dans un rapport où une matière inerte serait en train d’être modelée par une volonté unique, la mienne, soi-disant, ou celle de mes lecteurs. C’est ce rapport, et permettez-moi d’insister sur ce mot, qui est non seulement difficile à expliquer, mais qui est aussi très fragile. On a vite fait de perdre le fil, comme on se lasserait d’écouter une voix sur une mauvaise ligne de transmission. On a vite fait de vouloir «tordre» le texte pour qu’il aille dans un sens plus populaire, ou davantage dans l’air du temps, quitte à ne pas respecter sa trame, qui serait comme celle d’un tissu.
Les tentations sont nombreuses, en cours d’écriture, parce qu’il s’agit d’un travail sur le long terme, et que les incertitudes et les doutes sont aussi puissants que les moments d’exaltation. Ce travail d’écoute du texte lui-même ne tolère, à mon sens, aucune interaction avec l’extérieur. Sous peine de tomber précisément dans un produit en train d’être fabriqué, plutôt qu’un texte en train d’être créé.
Il y aurait beaucoup à dire encore à propos de l’extrême délicatesse, et des exigences particulières, liées à un processus de création artistique, qui ne touchent d’ailleurs pas que la littérature, j’en suis persuadée. Je préfère m’arrêter ici dans cette réponse, cher Guy, sans toutefois oublier de vous confier l’essentiel: le lecteur, je l’écoute volontiers après coup. Je l’écoute même avec beaucoup d’attention et de plaisir, non pas pour comprendre ce qu’il souhaite pour la suite, mais afin de percevoir ce que le texte lu lui a fait. Quelles réflexions ce texte a-t-il suscitées, quels miroirs a-t-il tendus, quelles résistances a-t-il déclenchées, quels bonheurs a-t-il fait naître?
Car si le texte en question – et ce n’est pas le moindre des paradoxes – n’a pas été écrit pour le lecteur, ni même en pensant à lui, c’est pourtant bel et bien à lui qu’il est adressé, à ce vaillant lecteur d’aujourd’hui et, si tout va bien, à celui de demain et d’après-demain.
Une suggestion de lecture:
Donc c’est non, de Henri Michaux>
Un recueil de lettres telles qu’on n’oserait ni ne pourrait se permettre d’en écrire de nos jours, sous peine de disparaître corps, âme et biens, en tant qu’artiste, dans un nulle part aux dimensions déjà prodigieusement enveloppantes...
Pourtant, cet écrivain et peintre d’origine belge, mort en 1984, l’a fait: dire non et non, et encore non, à toutes les propositions visant à le faire connaître davantage et à élargir sa palette de lecteurs. Il a même refusé des publications en livre de poche ainsi qu’une édition dans la Pléiade! Une position extrême, quasi suicidaire, mais relevant d’une grande cohérence. Tout ceci n’a pas empêché la sortie de ses textes en Pléiade après sa mort.
Le lit-on encore largement? Je l’ignore. Le lit-on moins aujourd’hui que d’autres écrivains qui ont passé leur temps à tout accepter? Je l’ignore également. Michaux demeure à coup sûr un maître pour celles et ceux d’entre nous qui voudraient prendre le risque de dire non plus souvent, ou qui tiendraient déjà par commencer à apprendre à le dire.
© catherine lovey, le 17 février 2017
C'était...